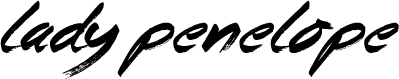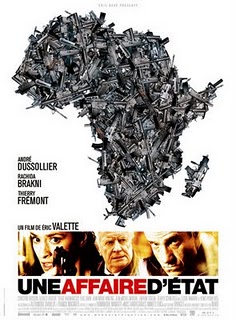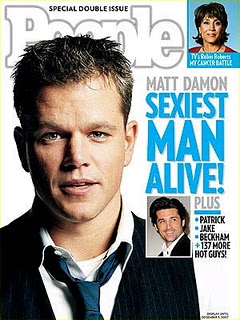Dimanche, c’est journée ciné. Je suis allée voir Le Concert de Radu Mihaileanu qui est une vraie réussite. Un ancien chef d’orchestre condamné à faire le ménage depuis 30 ans se lance le pari fou de jouer à Paris avec les membres de son Bolchoi « historique ». Une entreprise certes musicale mais surtout une épopée entre théâtre du Chatelet et siège du PC à Paris. Je ne suis pas une grande fan de Mélanie Laurent mais elle m’a agréablement surprise. Les autres comédiens, au premier rang desquels Aleksei Guskov sont à la fois drôles et touchants. La musique de Tchaikovski accompagne le tout, bref, un bon moment de cinéma.
Maintenant, le plus important, il faut préciser que j’étais dans de (très) bonnes dispositions dès le début de la projection. Celle-ci avait été précédée par la diffusion de la dernière pub Nespresso. Dernière, on pourrait presque dire « ultime » puisqu’il ne s’agit de rien d’autre que de la mise en scène du décès brutal (une chute de piano ne saurait être qualifiée autrement) de notre idole et je parle ici autant au nom de Mademoiselle Mécanique que de Lady Penny. L’ami George se retrouve ainsi ad patres, devant argumenter, comme beaucoup doivent essayer dans la même situation, pour être certain qu’il ne s’agisse pas d’une regrettable erreur de calendrier. En face, un John Malkovich excellentissime, qui malgré la certitude de tenir à jour ses registres d’entrées au Paradis, n’est pas contre un petit arrangement entre amis…
Encore une fois, un presque court-métrage qui régale le public. Oui à George, oui à John, oui au violon de Tchaikovski, oui au piano de George et oui je suis super bon public quand il s’agit de môssieur Clooney. Que voulez vous, on ne se refait pas.
Mais surtout, le meilleur café du monde dépend de la personne avec qui on le savoure.