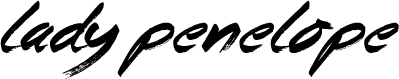Mini moi 1 étant partie pour un raid raquettes-luge de l'extrême, mini moi 2 s'est empressée de faire jouer la corde (super sensible) de ma fibre maternelle pour me convaincre, à grand renfort de sourires et de mamours, de l'emmener voir Raiponce, le dernier opus de Disney. Non que je n'aime pas les dessins animés, et encore moins les contes de fées, mais bon. Autant je reste fan définitive et éternelle de La belle au bois dormant, Cendrillon, La petite sirène, Blanche Neige ou encore La belle et le clochard, autant les "princes charmants" n'étaient plus vraiment les thèmes de prédilection de la maison du regretté Walt. Fut un temps où Disney nous avait asséné son lourdaud Hercule, véritable ode au marketing léger façon 38 tonnes à côté duquel Sex & the City (surtout 2) semblait dépourvu de toute dimension commerciale. Mini moi a eu raison de mes hésitation et nous sommes parties à la découverte de l'histoire de la jolie Raiponce, alias Rapunzel dans le conte original (comprendre avant "réécriture sévère") des frères Grimm.
Mini moi 1 étant partie pour un raid raquettes-luge de l'extrême, mini moi 2 s'est empressée de faire jouer la corde (super sensible) de ma fibre maternelle pour me convaincre, à grand renfort de sourires et de mamours, de l'emmener voir Raiponce, le dernier opus de Disney. Non que je n'aime pas les dessins animés, et encore moins les contes de fées, mais bon. Autant je reste fan définitive et éternelle de La belle au bois dormant, Cendrillon, La petite sirène, Blanche Neige ou encore La belle et le clochard, autant les "princes charmants" n'étaient plus vraiment les thèmes de prédilection de la maison du regretté Walt. Fut un temps où Disney nous avait asséné son lourdaud Hercule, véritable ode au marketing léger façon 38 tonnes à côté duquel Sex & the City (surtout 2) semblait dépourvu de toute dimension commerciale. Mini moi a eu raison de mes hésitation et nous sommes parties à la découverte de l'histoire de la jolie Raiponce, alias Rapunzel dans le conte original (comprendre avant "réécriture sévère") des frères Grimm.
Une jolie princesse blonde est dotée d'une chevelure d'or qui garantit la jeunesse éternelle. Il n'en faut pas plus pour que la vilaine sorcière Gothel n'enlève le bébé et l'enferme dans une tour pour l'élever loin du monde. Notons que Gothel est doublée par Isabelle Adjani qui prête sa voix avec succès à la retorse kidnappeuse. Au risque d'essuyer un lynchage en règle, j'avoue ne pas adhérer à cette actrice considérée comme un monstre du cinéma français. Dans ce cas précis, je dirais simplement que la mégère lui va comme un gant… Mais revenons à notre héroïne et à son héros. Le jeune, beau et arrogant voleur Flynn Rider, poursuivi par des acolytes peu sympathiques, se réfugie près de la tour, rencontre la princesse et accepte de l'accompagner au royaume (je fais court mais si je dis tout, mini moi va m'en vouloir de déflorer le sujet donc chut). Evidemment, le voyage n'est pas sans embuches, évidemment belle-moman s'en mêle, évidemment on ne passe pas loin de la cata et évidemment tout finit bien. Il faut dire qu'avec des cheveux pareils, Raiponce le vaut bien (oui elle était facile mais je n'ai pas pu résister…). Cerise sur le gâteau, et pour en revenir à mon affaire de doublage, c'est le sexyssime Romain Duris qui double Flynn dans la version française et là, définitivement, je vote pour.
Ce qui était au départ la BA de Noël s'est ainsi avéré un joli moment de cinéma : techniquement les effets servent le film et ne lui servent pas d'alibi, "ni trop, ni trop peu". Les cheveux de Raiponse sont une très belle réussite (je n'ai néanmoins pu m'empêcher d'imaginer les séances coiffage d'une toison longue de plus de 20m mais comme ils sont magiques, ça doit être plus simple qu'avec les crinières auto-nouantes de mes minis). Une histoire de princesse qui reprend l'équation fondamentale sorcière-prince-"ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants" pour le bonheur de mini moi 2 (celle qui avait demandé un jour si le prince charmant existait ou pas…) et de sa maman qui est décidément une irrécupérable romantique.