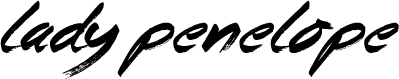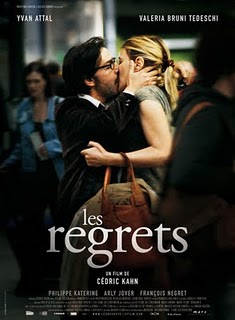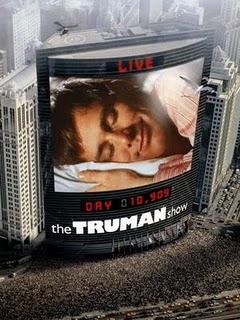Décidée à une séance familiale, le choix s’est porté sur Le petit Nicolas, le petit bonhomme au débardeur rouge, interprété par Maxime Godart (trognon tout plein), dont plusieurs générations ont suivi les aventures, savamment inventées par Goscinny et Sempé.
Nul n’oublie Agnan-le-chouchou-de-la-maîtresse-qu’on-ne-tape-pas-parce-qu’il-a-des-lunettes, Clotaire l’étourdi, Geoffrey et les sous de papa, Rufus qui s’y connaît en bandits parce que papa est policier, Alceste qui conjugue saucissons et gâteaux à tous les modes de cuisson. Il y a aussi la jolie maîtresse et Le Bouillon, le surveillant général, spécialiste en recopiage à l’échelle industrielle. Le casting des gamins est excellent et ils portent le film à eux tous seuls.
Patatras, en fait nous avons eu droit au pire. Bon d’accord, je nuance mon propos et je reconnais les (déjà) 2 millions d’entrées. Les moins de 12 ans se sont régalés. Couleurs acidulées (surtout le maquillage de Valérie Lemercier, qui n’a rien à envier au bleu EDF), jolie 404 rouge de papa Kad ou encore Rolls Royce conduite par un jeune garnement qu’on penserait sorti de Mars Attacks (n’importe quoi Lady Péné, vu son âge, à la sortie du film de Tim Burton, il n’était même pas né), bermudas et culottes courtes, tout y est pour le plaisir des plus jeunes. Si on ajoute quelques gags légers comme une boite de raviolis en conserve ou un créneau made in Rémi Julienne, on peut s’arracher un sourire jusqu’à 14 ans.
Oui j’ai la dent dure, je l’admets et à ce point, ça ne m’arrive pas souvent. Mais voilà, le il s’agit de ma première BD de môme et j’espérais mieux. Certes, les histoires du petit Nicolas répondent à une écriture particulière, en épisodes. Mais il est dommage d’avoir tenté de reproduire ce modèle à l’écran. Une telle adaptation, bien que celle-ci ait été supervisée par Anne Goscinny elle-même, aurait mérité plus d’efforts et un tous cas un scénario plus nourri. Un peu, beaucoup, à la folie trop léger à mon avis.
Au final, les petits s’amusent certes, mais les grands, élevés au Petit Nicolas ressortent pour certains déçus. Pfff dommage…
Un coup de coeur spécial à la musique de Renan Luce, que petits et grands fredonnent sortant de la salle.